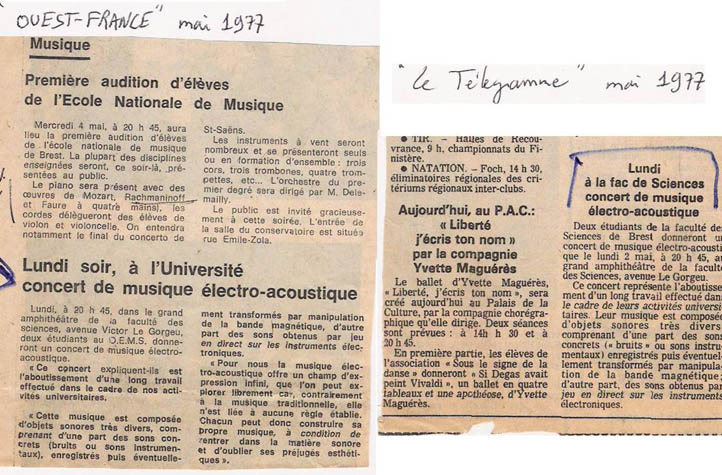"Les San Francisco Contemporary
Music Players en collaboration
avec le Center for New Music and Audio Technology de Berkeley
ont présenté un concert de musique mixte avec des
oeuvres de Kaija Saariaho, Nicolas Vérin, Laetitia Sonami,
Edmund Campion et Jonathan Harvey, sous la direction de Linda
Bouchard. ... Instabile,
de Nicolas Vérin,
pour 9 musiciens et électronique, était
peut-être
l'oeuvre la plus exquise de la soirée. La musique de M.
Vérin fait montre de toute la subtilité d'un
genre
qui n'est pas concerné par la note, et qui cherche
à
intégrer les instruments et l'électronique dans
un seul monde sonore naturel. À la différence des
dialogues entre acoustique et électronique de la musique
de Campion et de Saariaho, le travail de Vérin
créé
un voile unique qui semble émaner tant des instruments
que des haut-parleurs. Des sections de l'oeuvre fusionnées
comme le meilleur Scelsi sont entrecoupées par des sections
anguleuses qui mettent en valeur les harmonies en relation avec
les sons multiples. Le dispositif électronique comprend
des sons échan-tillonnés ou
électroniques
ainsi que des traitements en direct déclenchés
par
le pianiste et un techni-cien qui suit la partition. Oeuvre la
plus complexe sur le plan technologique, elle a pleinement
bénéficié
de la préparation soigneuse de la soirée. La
cohésion
de la pièce vient de la corrélation minutieuse
entre
les timbres et les autres paramètres. Les sons
multiphoniques
des vents fournissent le matériau de base ainsi que le
modèle pour l'orchestration et le langage gestuel.
Vérin
tire des multiphoniques leur caractère instable et vacillant
pour l'étendre à tous les aspects de la
pièce.
Le monde sonore qui en résulte ne se fissure jamais en
des rôles distincts. L'oeuvre est de bien des
façons
extrêmement difficile, requérant un
contrôle
virtuose des hauteurs à l'intérieur des
multipho-niques
et une compréhension de la nécessité
pour
les solistes de fusionner, ce que l'ensemble a accompli de
manière
admirable.""
Eric Marty, Computer Music
Journal, Printemps 1998.

"Si vous donnez carte blanche à Nicolas Vérin, il est fort àpenser que la musique de chambre diffusée à Musicalta tienne peu de place dans son programme. Samedi soir àla salle de la MGEN des Trois-Epis, le jeune compositeur, après une conférence fort intéressante sur la musique électroacoustique, passait àla pratique. Moment exceptionnel quand on sait combien il est rare qu'un tel événement se produise dans la région. En tant qu'auditeur, quand vous êtes engagé dans une telle aventure, les grandes interrogations qui vous viennent àl'esprit sont multiples. Mais heureusement, àl'issue de toutes ces pièces, les réponses n'étaient pas pour autant absentes. Et c'est peut-être là le mérite de cette "technique". Les sons que l'on subit, les ambiances qu'on façonne, les onomatopées sonores que l'on répand avec science et art, où se cache le mot musique ? Mozart, Stravinsky et même Berio dans ses meilleurs jours, en quoi peuvent-ils être des précurseurs ? La réponse positive des explorateurs de ce nouveau monde, la négative de ses détracteurs, ne peuvent qu'ouvrir le débat dont les affirmations susciterons encore bien des passions. A l'issue de la soirée, le public avait compris qu'il venait de vivre deux heures d'intensité forte, flottant tour à tour dans un monde pas si irréel que ça, mais oû chacun pouvait puiser énergie, rêve, ou même une parcelle de poésie." L'Alsace, 26 juillet 1999.
Dernières
nouvelles d'Alsace, 26 juillet
1999.
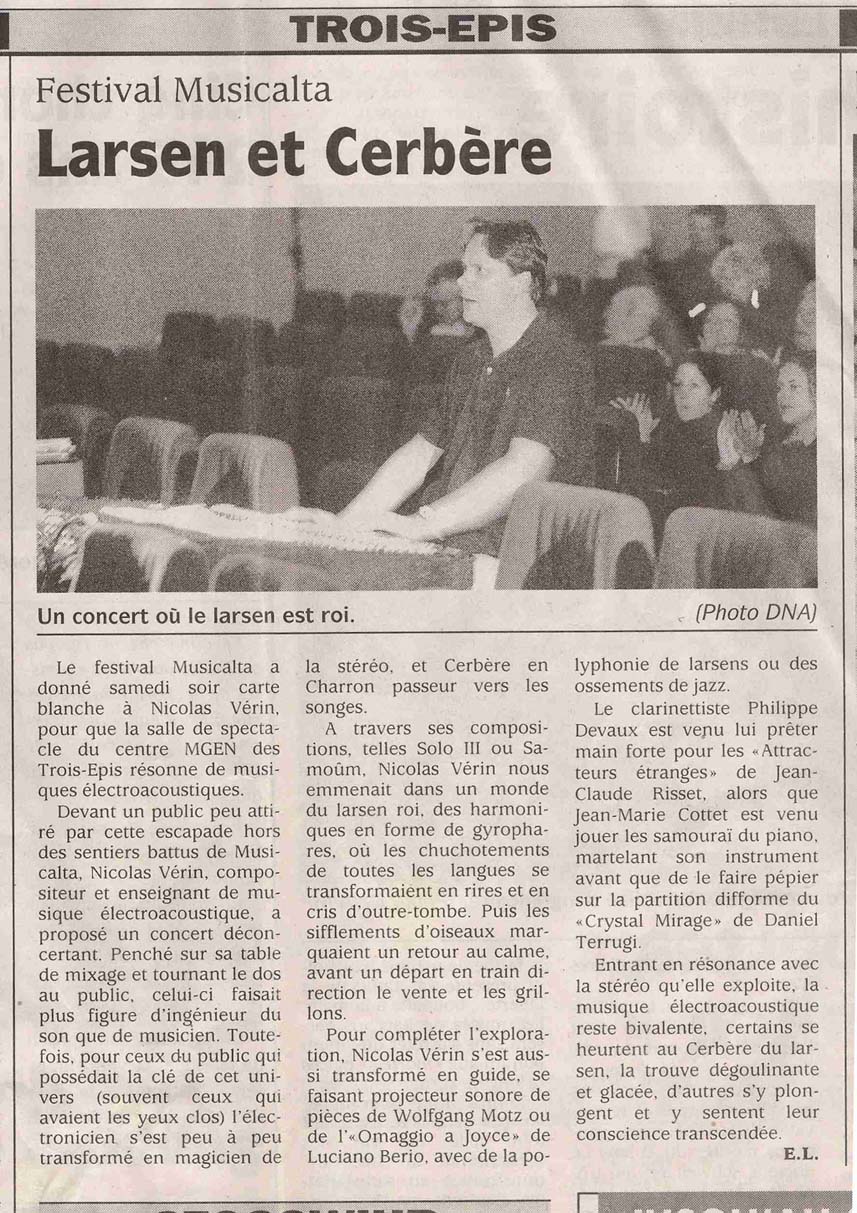
"Le swing intérieur
était chez Pierre Guignon,
improvisant magnifiquement sur une bande magnétique de
Nicolas Vérin, d'une poésie permanente. La
percussion
n'est plus ici l'esprit frappeur mais du son caressé,
frotté,
modulé, aux multiples timbres, un matériau dont
un compositeur peut s'emparer pour bâtir son monde : Nicolas
Vérin, très bon électroacousticien,
jeune,
talentueux, implanté dans la région, magnifique".
Jean-Louis Roy, sur Vent du Sud.
Euridyce
délivrée.
Janvier 1998 (Dijon).
"Dans deux cas seulement ce lundi, pouvait-on oublier le "comment" et se concentrer sur le "quoi". Les deux pièces pour instrumentation multiple procuraient plus de satisfaction. Vérin cite tant d'influences dans les notes de programme, qu'on se pose des questions. Toutefois Instabile, pour neuf instruments fait passer les musiciens à travers toutes sortes d'épreuves, depuis des sons multiples jusqu'à des rythmes imprévisibles, et évoque une atmosphère nébuleuse et rêveuse. Vérin intègre son usage de la technologie en quête d'un exposé plus vaste. Des archets de violon sont frottés sur des instruments de percussion. Des balais sont introduits dans le piano. Et l'oreille détecte une arche qui se déploie et un apaisement graduel." Allan Ulrich, San Francisco Examiner. 11 février 1998.
"Le spectacle Arrêts
fréquents passe
magnifiquement au disque. Aux côtés d'Anton
Webern,
nec plus ultra de l'expression concentrée, et de Kurt
Schwitters,
référence latente de cette entreprise d'esprit
dadaïste,
figurent quelques nouveaux maîtres de l'aphorisme musical.
Bien que l'effectif instrumental varie de pièce en
pièce,
trois tendances se dégagent avec de notables
réussites
: la pirouette anecdotique (Nicolas Vérin, Bruno Giner),
le tableau abstrait (Jean-Luc Hervé, Aurel Stroé)
et la saynète humoristique (Richard Dubelski, Dominique
Clément).
Pierre Gervasoni, Le Monde.
Samedi 30 mai 1998.
"Chassé-croisé
contemporain. Le
concert dominical du festival Musicalta a été
dominé
par la présentation d'une oeuvre inédite de
Nicolas
Vérin. C'est presque
devenu une habitude, le festival
Musicalta crée chaque année une oeuvre de Nicolas
Vérin. L'année dernière on avait
découvert
Chassé-croisé II, pour piano et violon, la 2e
pièce
de ce cycle dédié aux interprètes, des
oeuvres
qui mettent en scène deux instrumentistes et exploitent
habilement le potentiel expressif de ces rencontres. Cette
année,
Nicolas Vérin s'est consacré à la
clarinette
et à l'alto, aux clarinettes plutôt puisqu'on
retrouvait
également le cor de basset. Trois instruments donc, trois
protagonistes pour une curieuse partie qui tenait autant de
l'échange
de paroles que du dialogue de sourds. Car si les deux instrumentistes
développent bel et bien une forme de discours, leurs points
de rencontre ne sont pas si fréquents. En fait, ce Chassé-croisé
I a tout de la joute oratoire et
la prise de parole de ses
personnages musicaux reste d'autant plus passionnante qu'elle
se révèle, au fil du discours, totalement
multiforme."
Mathias Heizmann, Dernières
Nouvelles d'Alsace.
21 juillet 1997.
"Mendelssohn et
Vérin. (...) L'oeuvre de Nicolas
Vérin, Chassé-croisé
III, pour deux
violons - Francis Duroy et Nathalie Geoffray - fut en revanche
une très grande réussite en matière
d'investissement
musical et d'équilibre sonore. Pas une chute de tension
dans cette oeuvre étrange hantée par les
glissandos,
un chassé-croisé qui prend parfois des allures de
course-poursuite et dont l'énergie rythmique ne faiblit
jamais".
Mathias Heizmann, Dernières
Nouvelles d'Alsace.
23 juillet 1997.
"Un goût
immodéré pour la vie. Pour
sa troisième soirée musicale, le Festival
Musicalta,
aux Trois-Épis, s'est tourné vers la musique
contemporaine
avec une oeuvre de Nicolas Vérin donnée en
création
mondiale. Chassé
Croisé II pour violon
et
piano est en effet l'avant-dernière pièce d'un
cycle
de duos dédiés aux interprètes qui les
ont
suscités. En choisissant une création les
organisateurs
de Musicalta on montré leur goût du vivant, suivis
par un public franchement enthousiaste et grandement adolescent.
Il faut dire encore, que cette oeuvre, particulièrement
difficile pour les interprètes, fut admirablement
jouée
par le pianiste Jean-Marie Cottet et le voloniste Francis Duroy.
Dialogue parfait et vitalité époustouflante, les
multiples aspects de ce chassé-croisé furent mis
en valeur, comme ces harmonies récurrentes un peu
inquiétantes
ou cette rythmique implacapble qui n'allait pas sans rappeler
certaines oeuvres de Prokofiev."
Mathias Heizmann, Dernières
Nouvelles d'Alsace.
Juillet 1997.
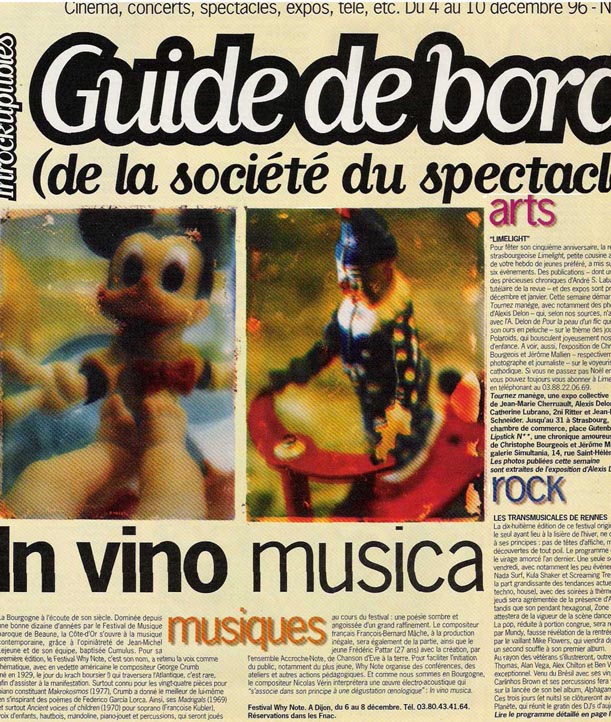
"Nicolas Vérin a
utilisé des icônes sonores qui deviennent une
partie essentielle de ce 'temps perdu' pour lui ; il essaie de
transmuter son expérience intime en un fait communicationnel
pour le faire objectif, commun à tous et proche des
auditeurs. 11, avenue du Midi
frappe plus si on l'écoute chez soi, car elle
interfère avec les sons de sa propre maison,
interférence très riche et paradoxale."
José Igès,
émission Le rythme et la raison, France-Culture,
25-1-96
"Au répertoire des
pièces mixtes et
intéressantes,
il faudrait inscrire Mariposa
clavada que medita su vuelo de
Nicolas Vérin. On y trouve une aisance toute classique,
un ton pas le moins du monde laborieux et un mariage d'amour entre
la flûte de Cécile Daroux et la bande
où se
mire l'instrument dans une relation apparemment harmonieuse, toute
en polyphonies complexes, séduisantes et insaisissables.
Cela dit, je me demande si l'intérêt majeur de ce
morceau ne résiderait pas avant tout dans la partie de
flûte, à laquelle Vérin donne un
caractère
incantatoire comme chez Debussy ou Jolivet, avec l'indispensable
mélange des modes d'utilisations traditionnels et modernes."
Jacques Bonnaure, La Lettre du
musicien. no.175, mars 1996.
"Mariposa clavada que medita su vuelo : tragique... nostalgie de la vie après la mort ; nous allons voir ce que cela donne en musique (nostalgie de la vie près de la mort). L'auteur en parle bien : j'ai reconnu dans les meilleurs moments ce jeu d'imbrication-désimbrication de la flûte, qui 'mariposa clavada' tantôt s'englue (et baigne tragiquement dans la colle, délicieusement aussi), et tantôt d'un coup d'aile prend son essor curviligne et lyrique. Une flûte qui rentre le souffle devant - souffle de l'arrière-gorge - et qui ensuite mêle discrètement son éraillement et sa couleur en camaïeu à la matière des sons de la bande : laquelle on soupçonne également, brillante comme de l'alu, être remplie de flûte dissoute. Jeu de cache-cache, du zèbre et de la grille, la flûte se perd et se dilue dans le milieu saturant qui l'accueille. Timide et insistant motif (en degrés conjoints : do-réb, réb-mib) qui s'égare et barbote mais parvient à se dégager, joliment." Jean-Christophe Thomas, Recherche-Musique. Mars 1996.
"De La Lueur et la fumée, on retiendra la sensation d'être suspendu, en équilibre vacillant, entre le mot, le son, la voix parlée, la voix intérieure, l'ombre et la lumière. Nicolas Vérin a conçu une scénographie, une vraie mise en espace et en lumière en collaboration avec Daniel Laloux et Jean-Marc Colonna d'Istria, pour se donner toute la liberté qu'offre le poète. En miroir avec ces textes, opposant un univers intérieur à une errance urbaine, un rêve de la beauté idéale au réel, au quotidien, Nicolas Vérin joue sur de multiples facettes. La partition traduit fondamentalement l'obsession du temps chez le poète : contrastes incessants des jeux rythmiques autour de pulsions régulières et irrégulières, martèlements, étirements, répétitions, passages "senza tempo" qui se heurtent et s'enroulent autour de la voix, en créant un subtil décalage, sur la tension-détente des mots, des phrases. Il multiplie les effets de lointain, de proximité, donnant le sens à entendre d'une voix parfois soliste, parfois en polyphonie avec les instruments. Il oppose la mélodie à un magma sonore, tisse un trame serrée avec synthétiseur, bandes magnétiques et instruments acoustiques. La partition se nourrit de tous ces décalages, de toutes sortes de ruptures, avec des instants de réelle poésie, en toute indépendance, ou rejoignant, devançant, cassant, suivant le mot, le rythme des poèmes dits par Daniel Laloux. Mise en musique, musique en écho, interlude savant... ". Élisabeth Pistorio, Révolution, No. 723 du 6 janvier 1994.
"Autour d'une informatique musicale, qu'il maîtrise remarquablement, il propose la musique d'un drame énigmatique et proche. Il aime à transformer les voix, les sons, pour en faire un fleuve sonore naissant, contournant et décrivant les creux et les reliefs du paysage. Sa musique porte une narrativité piégée, connotative à l'extrême, et toujours elle en transmet une charge nostalgique et émotionnelle." in La musique contemporaine en France en 1994. Chroniques de l'AFAA No. 5
"Retornelo : Nicolas Vérin nous montre qu'outre son intérêt pour les techniques électroacoustiques et les modes de jeu les plus actuels qui marquent en général ses productions, il aime aussi partager le plaisir d'un groupe d'instrumentistes animés d'une belle énergie. On trouvera peut-être dans cette pièce une influence de la musique américaine, des rebonds rythmiques propres au jazz aux sonorités cuivrées qu'il demande ici aux vents. On a affaire ici à une pièce de concert extrêmement communicative, très "public", au meilleur sens du terme !" David Lacroix, catalogue des Éditions du Visage, 1994.
"In vino musica : La musique du Mauzac, légère, terrienne, sans excès, avec un petit goût de rivière un peu pierreuse... le Lenc de l'elh propose une pointe de stridence adoucie de clochettes lointaines. Un peu exotique, un son grave et sec, et un oiseau électronique la complètent. Il y a là comme un de ces souvenirs qui s'évanouissent quand on le saisit, des notation gustatives et auditives sonores trop brèves qui laissent pourtant une impression indéfinissable... Le Syrah est un vin/musique ancré, fort, qui attaque avec une acidité qui disparaît tout de suite. Sons ou paroles lointains, chuchotés, liquides, graves, c'est rugueux et vrai comme de la toile de jute. Le Duras est un vin dont le son a beaucoup voyagé, beaucoup engrangé d'odeur d'herbes, de racines de réglisses chauffées au soleil, de rosées et de brume d'automne. Il se raconte comme au coin du feu. Enfin, le Braucol est une musique élaborée, réfléchie, avec des souffles de bambou électronique, c'est un vin d'aujourd'hui, avec des sons vocaux, où chaque instant on mord dans des poignées de baies âpres et odorantes, on part en voyage." Michel Thion, Révolution no. 673 du 21 janvier 1993.
"Circuitio
est le premier volet d'un travail
expérimental
sur les possibilités du Quatron, un instrument qui donne
une musique véritablement électronique, loin de
toute imitation d'instruments classiques, et permet de
surcroît
l'improvisation, la liberté d'expression en temps
réel.
Cette ronde autour d'un instrument, avec des tempi autonomes,
des variations de timbre, était
interprétée
et improvisée par Pascal Gaigne au Quatron, Michael Riessler
aux saxophones et Gérard Siracusa aux percussions. Avec
un début très syncopé, la musique a
pris
de l'ampleur. A la fin du morceau, avant des applaudissements
fournis, un silence a plané, comme au commencement. Mais
entre temps, un autre monde avait été
esquissé".
Marie-Laurence Wernert, Sud-Ouest
du 4 octobre 1993.
"Métalmorphose
de Nicolas Vérin joint
aux charmes très "roaring sixties" de la percussion
ceux, plus modernes, du Syter. L'écriture percussive est
toujours fille, petite-fille même d'Ionisation de
Varèse,
encore que l'utilisation du vibraphone y introduise des fragments
mélodiques. Cette oeuvre réintroduit le geste
théâtral
et virtuose au milieu du vide de l'Acousmonium, et cette dialectique,
dramatiquement efficace, ouvre une piste féconde."
Jacques Bonnaure, La lettre du
musicien no.98, janvier
1991.
"...Quand on a donné
l'intégrale de mon
oeuvre au Musée d'art moderne en 1988, Nicolas
Vérin
était avec moi depuis trois ans. Si je devais avoir des
dauphins, il serait l'un des meilleurs."
Pierre
Henry, in Cécile
Gilly et Claude Samuel, Acanthes
An XV, Van de Velde, juillet
1991.
"...les Miroirs
déformants de Nicolas
Vérin,
mariant un hautbois solo et une bande magnétique assez
belle et dramatique, qui témoignent d'une certaine
imagination
sonore. "
Jacques Longchampt, Le Monde
du 3 juin 1989.